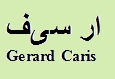© Uli
Bohnen
INTER DIMENSIONES
-
L'ESPRIT ET LA NATURE
DANS L'OEUVRE PLASTIQUE DE GERARD CARIS
L'évidence avec
laquelle Gerard Caris réussit à assembler ses éléments
plastiques de base, pentagones réguliers (bidimensionnels) et
dodécaèdres à faces pentagonales {tridimensionnels), en des
structures complexes repose sur une illusion. Quiconque essaie
de construire une mégastructure à partir d'éléments de ce type
a tôt fait de remarquer que ceux-ci se laissent combiner non
sans difficultés en motifs harmonieux - contrairement à
l'hexagone régulier, par exemple- .
Pendant longtemps, on a
conclu que les activités de l'artiste autour de ces formes
précisément difficiles à combiner avaient un caractère
particulièrement artificiel et peut-être même un caractère
"contre nature". Car on avait toujours cherché dans la nature
(y compris dans le monde très polymorphe des cristaux) des
phénomènes basés sur des pentagones réguliers. Certes, on
rencontre parfois des pentagones, par exemple dans la pyrite,
mais ils ne présentent jamais la régularité que nous voyons
dans les rayons de miel (hexagonaux) ou dans les cristaux, qui
sont basés sur d'autres modèles.
Lorsque en 1984 on
observa pour la première fois des complexes de pentagones
réguliers dans un alliage rapidement refroidi d'aluminium et
de manganèse, ces complexes furent qualifiés de
"quasi-cristaux" parce qu' ils avaient été synthétisés par des
scientifiques. Cependant, presque personne n' a trouvé là de
raison pour considérer ces produits ou ces tentatives visant à
parvenir à ces produits comme étant contre nature - ou bien il
faudrait aller jusqu' à considérer toute recherche effectuée
par des êtres humains comme l' expression de l' inadéquation
fondamentale face à la nature: le coup-de-poing en tant que
chute... Dans ce cas, toutefois, l'histoire de chaque culture
ou de chaque civilisation n'est rien d'autre qu'une
accumulation de manifestations contre nature qui se sont
produites après que l'être humain eut été chassé de
l'Eden.
Si l'on considère que
l'esprit nous sépare de la nature tout en nous y reliant, la
relation plastique avec des éléments apparemment contre nature
tels que le pentagone n'est plus un "divertissement" ou une
prétention isolée de la réalité.
Non seulement parce
que, dans toutes nos activités relatives à la civilisation et
à la culture, nous n' approchons la nature que de manière
intermédiaire, mais également parce que, dans un sens
probablement beaucoup plus large - et plus surprenant, en ce
qui concerne les perspectives de cet élargissement -, nous
nous demandons dans quelle mesure la nature elle-même peut
manifester un "esprit".
Car si la relation avec
le monde des formes auquel Gerard Caris se consacre maintenant
depuis bientôt quarante ans - d' abord conçu et couché sur le
papier de façon spéculative, puis élaboré sous forme sphérique
- se révèle si difficile, c'est peut-être précisément parce
que la combinaison des éléments pentagonaux touche la
frontière de notre monde familier
tridimensionnel.
Depuis que la théorie
de la relativité d'Einstein nous a confrontés au concept
délicat d'espace-temps en tant que continuum
quadridimensionnel cohérent, notre représentation populaire
d'une section plane (bidimensionnelle) et d'un espace
(tridimensionnel) se trouve aussi profondément remise en
question. On aurait pu revoir non seulement le vocabulaire
quotidien, mais aussi et surtout le vocabulaire utilisé
jusqu'à présent dans les milieux artistiques après le
développement du calcul logarithmique au dix-septième siècle,
la découverte par Gauss de la géométrie sphérique curviligne
non euclidienne au dix-huitième siècle, et la poursuite de ces
travaux dans le cadre des sciences physiques par Bernhard
Riemann au dix-neuvième siècle. Mais la représentation
populaire susmentionnée resta pratiquement
intacte.
Il est déjà assez
surprenant que Robert Lebel cite la réflexion suivante de
l'aphoriste relativement pondéré que fut Marcel Duchamp: "Un
objet tridimensionnel jette une ombre à seulement deux
dimensions." Toujours cité par Lebel, Duchamp en conclut
"qu'un objet tridimensionnel, quant à lui, doit être l'ombre
d'un objet quadridimensionnel."1 Ainsi, par une
analogie subtile, il tente de rapprocher de nous quelque chose
que nous ne pouvons pas nous représenter - même si nous
pouvons le concevoir! - à l'aide de quelque chose que nous
pouvons nous représenter.
Si je rapproche de
l'oeuvre de Gerard Caris cette manière dont un artiste
appréhende les problèmes posés par les sciences de son temps,
c' est que le travail intensif fourni depuis des années par
cet artiste néerlandais sur un élément aussi "rebelle" au
niveau de l' esthétique que le pentagone régulier se retrouve
chez les scientifiques qui s'adonnent à la cristallographie -
avec un vocabulaire, certes, qui décrit d' autres activités
professionnelles que celles de Caris. Car depuis que l'étude
microscopique de l'alliage d'aluminium et de manganèse
mentionné ci-dessus a conduit à la découverte surprenante que
sa structure cristalline se compose de pentagones réguliers,
les scientifiques eux-mêmes cherchent à savoir comment cette
composition se laisse concilier à notre notion de
tridimensionnalité. En effet, comme Caris doit, lui aussi, le
reconnaître, aucun modèle ne permet de réaliser ni de se
représenter une combinaison sphérique de ces éléments qui soit
fermée et parfaitement ajustée.
Des hypothèses
théoriques qui ont été formulées jusqu' à présent pour
expliquer l' apparition des quasi-cristaux susmentionnés, les
plus importantes sont cel les qui donnent la possibilité de
zones transitoires mobiles entre les dimensions désignées par
des chiffres entiers ou la possibilité du caractère
"hyperdimensionnel" de notre réalité. Que signifie
ceci?
Comme nous l'avons dit
précédemment, l'élargissement des mathématiques et de la
géométrie a eu lieu dès le dix-septième siècle avec le
maniement arithmétique et graphique de fonctions
interdimensionnelles et plus que tridimensionnelles, et
pourtant les artistes, à detrès rares exceptions près, en sont
restés à une conception traditionnelle de la surface plane et
de l' espace. Ici se révèle une distance regrettable de la
part des disciplines d'élaboration des formes face à cette
problématique. Il est possible toutefois que la relation entre
l' humanité et son milieu naturel dépende en principe d'une
notion plus adéquate de cette problématique. Et l'importance
de cette relation ressort précisément du désastre que nous
provoquons dans le monde entier avec notre notion de la
réalité, la technologie qui repose sur cette notion et tous
les phénomènes qui en découlent.
N'est-il pas logique de
soupçonner que les modèles simples de construction et la
violence mécanique avec laquelle nous allons au-devant de la
nature dans la pratique (quel que soit le degré
d'informatisation et d'automation de la recherche, de la
production et de l'exploitation) ne sont rien de plus que la
conséquence d'une incompréhension essentielle? Dans
l'aéronautique, on a certes appris à tenir compte des
glissements dans le temps et donc dans l'espace qui sont liés
à la vitesse; dans la mesure ou des vitesses extrêmement
élevées entrent en jeu, on sait également manier la relation
complexe espace-temps ou masse-énergie dans l' étude des
particules. Reste à voir si et comment ces connaissances
contiennent la clé permettant de mieux comprendre notre cadre
de vie quotidien peut-être en totale contradiction avec
l'affirmation d'Einstein selon laquelle la vision du monde de
Newton suffit pour comprendre le monde qui nous est
accessible.
L'hypothèse incertaine
que les cristallographes opposent à la structure pentagonale
de l’alliage aluminium-manganèse rapidement refroidi prend
peut-être, dans le cadre de notre réflexion, un sens beaucoup
plus important que ne le suggère à première vue l’objet limité
de leur étude. Cependant, ceci s'applique également à
l'activité esthétique de Gerard Caris.
Ses "complexes
pentagonaux" (comme il nomme lui-même ces constructions), tant
graphiques que sculpturaux, sont des fonctions d'un processus
exponentiel de multiplication qui se
traduit en spirales
logaritmiques, ou bien - dans une conception arithmétique -
s'abstrait en nombres logarithmiques. Ils symbolisent le
passage mobile et indéfiniment différencié entre des
dimensions représentables par l'arithmétique. Et cela vaut
aussi dans un sens plus spécifique et donc d'autant plus
vivant pour le monde formel de Gerard
Caris.
Mais ceci n' explique
pas tout. Quand l’artiste utilise son vocabulaire formel pour
construire des objets d'usage courant et se meut ainsi sur le
terrain d'une esthétique appliquée, il s'y manifeste des
aspects d'une modernité qui s'étend au-delà des périodes de
style et tend à la continuité.
Nous pouvons être plus
précis. Le radicalisme d'un certain nombre de représentants
éminents de l’art moderne de notre siècle s'est manifesté dans
des tentatives d'élargissement de leurs prétentions
métaphysiques à la transformation de la vie quotidienne
(prétentions provenant en partie d'un passé lointain et se
rapportant en partie à des questions de leur temps relatives
aux sciences physiques et sociales) ; et, en conséquence, ils
ont voulu mettre un terme à la distinction entre art libre et
art appliqué.
Néanmoins, la
conception populaire persiste encore de nos jours, selon
laquelle l'art, d'une part, et la vie quotidienne, de l’autre,
sont deux domaines séparés (et inconciliables), et
l’appréciation prédominante portée à l’art libre continue de
différer totalement de celle portée à qué. Face à cet
antimodernisme persistant, Caris s’en tient à des points de
vue modernes.
Pensons bien que les
fondateurs de I' art moderne ont certes recouru aux formes d'
existence et de pensée d'un passé lointain, mais qu'ils ne
l'ont pas nécessairement fait dans l'intention de donner une
nouvelle base à des capacités intuitives dissimulées. Car,
bien souvent, il fallait précisément se rattacher à des
manifestations d'une rationalité orientée différemment.
Inversement, de nombreux designers modernes n' ont pas fait
appel seulement à des théories relatives aux sciences
physiques parce qu'ils y cherchaient un soutien rationnel .
Car les physiciens, surtout, devaient constater à leur grand
étonnement que des unités tout à fait élémentaires, tels
l'espace, le temps, la masse et l'énergie, échappaient à la
sphère d'influence de la faculté humaine de représentation
justement lorsque les normes rationnelles de la recherche
étaient strictement appliquées.
Ainsi surgit une
situation apparemment paradoxale. Des philosophes, tels que
Nikolaus Cusanus (1401-1464) ou Baruch Spinoza (1632-1677),
qui avaient tant l'un que l'autre radicalize la pensée
mathématique de leur époque afin de prouver l'existence de
Dieu et qui, depuis Leibniz, étaient soumis par exemple au
calcul infinitésimal de nature immanente, ou (dans le cas de
Spinoza) au concept total de la Raison de plus en plus
éloignée de Dieu, - ces penseurs, donc, furent de nouveau
l'objet de besoins transcendantaux au vingtième
siècle.
Sans vouloir raviver la
foi en Dieu, un artiste comme Georges Vantongerloo
(1886-1965), par exemple2, a essayé, en recourant
expressément à Spinoza, de rendre ses implications
métaphysiques à la pensée mathématique et physique et, par là
même, d'élaborer des symboles plastiques dans l'esthétique
tant libre qu'appliquée. Cet élan explique les premières
peintures et sculptures abstraites de Vantongerloo, mais aussi
les meubles de bureau et les projets architectoniques - dont,
dès 1928, le modèle d'un aéroport!
Après la Première
Guerre mondiale, les révoltés socio-révolutionnaires en Europe
caressaient encore l’espoir que la synthèse de l'art libre et
de l'art appliqué se réaliserait rapidement, dans le cadre d'
une suppression générale de la division sociale du travail. De
cet espoir, toutefois, il n'est rien resté de plus qu'un noeud
dans le mouchoir de l’histoire et les efforts de certains
artistes cherchant à réaliser des changements subversifs de
modèles de perception irréfléchis à l'aide de moyens
plastiques.
A la lumière de ce que
nous avons dit plus haut sur les particularités
dimensionnelles qui caractérisent les "complexes pentagonaux"
de Gerard Caris, on ne peut nier que la tentative de
transformation de ces derniers en objets d' usage courant peut
susciter des irritations chez l’observateur, dont les
conséquences sont encore absolument
imprévisibles.
La "sanctification
métaphysique des surfaces planes" de Mondrian n' a certes
empêché aucun architecte qui y recourait de maintenir dans la
pratique la distinction délicate entre les surfaces
"exactement bidimensionnelles" et les surfaces "exactement
tridimensionnelles". Plus tard toutefois, des paradoxes espace
/ surface (comme dans l'op art ou chez Escher) ont clairement
montré les problèmes laissés par Mondrian. Dans son oeuvre,
Gerard Caris a focalisé et symbolisé la complexité
dimensionnelle de ces problèmes.
Caris, qui est
originaire du sud des Pays-Bas, est très familiarisé avec
l'oeuvre de Mondrian, de Vantongerloo et d'Escher3.
Mais son intérêt incessant pour le pentagone régulier qui ne
peut être multiplié ni de manière bidimensionnelle ni de
manière tridimensionnelle sans qu'apparaissent respectivement
des surfaces ou des espaces interstitiels de forme différente
ne s'explique pas uniquement par la tradition hollandaise et
flamande .4 Car, comme nous pouvons le voir dans
les renseignements biographiques qui figurent dans ses
catalogues, Caris a reçu sa formation artistique aux
Etats-Unis. Certes, les artistes auprès de qui Caris a suivi
des cours comptaient aussi un Britannique en la personne de
David Hockney, mais ses autres professeurs - tels que Richard
Diebenkorn et surtout R. Kitaj, avec lequel il entretient
toujours une correspondance - sont ou étaient des Américains
d'origine. Et leur manière de traiter les relations entre
l’espace et la surface plane a aussi considérablement
contribué, malgré toutes les différences apparentes au niveau
de l'esthétique, à la prise de cons-cience d' une identité
artistique par Gerard Caris.
Ainsi, dans les
"Seascapes" constructifs et à la fois sensibles de Diebenkorn,
la question de la profondeur spatiale, du sphérique n'apparaît
plus comme un phénomène objectif unilatéral, mais comme une
synthèse avec l'atmosphérique filtrée par des observations
subjectives. Dans les figures de Kitaj, nourries à toutes
sortes de sources sensorielles et idéelles et par conséquent
aussi "montées", il est presque évident que les éléments
hétérogènes - des "visions" dans la double acception du terme
- comprennent également des perspectives hétérogènes. Et dans
la reproduction colorée d'éléments emboîtés les uns dans les
autres, remplis de surfaces formant des angles entre elles
suivant des calculs précis (et donnant parfois une impression
ornementale), Hockney manifeste sa conviction que la rébellion
cubiste contre la conception spatiale centrée sur la
perspective n'a pas encore conduit, loin de là, à la
découverte de toutes les possibilités concevables, peut-être
même nécessaires.5
Il s'agit là d'un
héritage que Caris n'exploite aucunement, mais dans lequel il
recherche avec soin ce qui est utilisable pour symboliser les
correspondances concevables entre l'esprit et la nature - à
l’aide d' un vocabulaire visuel réduit issu des données
scientifiques -. Que ces correspondances ne se manifestent pas
sans conflits a toujours constitué une fatalité
anthropologique. Et le problème posé tant à Caris qu'aux
cristallographes par "l'insubordination dimensionnelle" du
pentagone régulier fait quasiment office de parabole dans ce
contexte. Car les tentatives des êtres humains, majorité
écrasante et forcée, visant à, se défaire de leur relation
avec la nature semblent aboutir à ce que l’histoire de la
nature devienne une fonction de l'histoire de l'humanité -
jusqu'à ce que cette dernière y trouve sa
fin.
A la lumière de ces
perspectives et face à une alternative fragile - ou bien une
escalade violente des revendications humaines sur la nature,
ou bien l'illusion naive d'une union immédiate avec la nature
-, il convient de s' interroger sur l' idée de l' esprit en
tant que nature transférée et de la nature en tant qu'esprit
transféré. L' oeuvre de Gerard Caris témoigne de manière
plastique des efforts que cette interrogation nécessite, mais
aussi du plaisir de savoir qu'elle laisse
entrevoir.
Notes :
1. Cette citation se
trouve in: Marcel Duchamp, Readymade. 180 Aussprüche aus
Interviews mit Marcel Duchamp. Cf. Serge Stauffer. Zürich,
1973. P. 11.
2. Cf. à ce suj et
notamment: Angela Thomas, Denkbilder . Materialien zur
Entwicklung von Georges Vantongerloo. Düsseldorf,
1987.
3. Il est très
intéressant de consulter des livres, commentés par Caris
lui-même, traitant d' artistes dont les conceptions sur les
dimensions le préoccupaient - par exemple la publication
mentionnée dans la note 2 ou le chapitre sur Escher in J. L.
Locher , Vormgeving en structuur. Amsterdam, 1973.
4. Cf. à ce sujet le
catalogue de l'exposition Gerard Caris. Brême, Kunsthalle
Bremen, 1993, en particulier pp. 15 et s.
5. Une référence donnée
par Gerard Caris a également été très utile pour ce résumé des
objectifs de Hockney: Art & Design Vol. 4, N° 1/2, Londres
1968 - consacré à David Hockney. Si Hockney y critique la
perspective centrale (découverte en Italie) en tant que
paramètre de l'art européen des 300 dernières années, il
oublie que des traditions très différentes de la
représentation spatiale ont aussi été développées au cours de
la même période en Europe, surtout en Flandres. Cf. à ce
sujet: Erwin Panofsky, "Die Perspektive als 'symbolischer
Form' ". In: idem, Aufsätze zu Grundfragen der
Kunstwissenschaft. Berlin 1985, pp. 99 et
s.